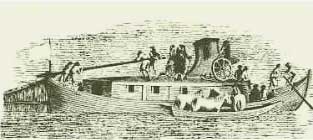
La péniche Freycinet
La généralisation des voies canalisées a profondément transformé les techniques de la navigation.
La profondeur à la fois accrue et garantie a permis d'augmenter la hauteur des péniches, c'est-à-dire leur tonnage; d'une façon générale, elle double.
D'autre part l'écluse standardisée par la Loi Freycinet
(1879) d'une forme parallélépipédique, longue de 40 m et large de 5,20
m, devient le gabarit universel des péniches de canal.
Les péniches vont
tendre à la remplir le plus complètement possible. Ce qui va définir leur
morphologie générale ainsi que certains trais de leur architecture: gouvernail
repliable, marquise démontable, etc...
De
l'Est et du Centre de la France, continuent de parvenir à Paris les produits nécessaires à la vie et au développement de la capitale: bois, matériaux
de construction, blés, vins, etc., véhiculés par d'autres bateaux de canal.
Ce sont les " toues ", les " flûtes ", les "cadoles
", les " margotats ", menés par des hommes bien différents
des mariniers du Nord.
La
canalisation des rivières par barrages mobiles éclusés, a fait naître
les grandes batelleries de canal tractionnées.
Elle a également provoqué
l'apparition de nouveaux bateaux, aussi longs et aussi larges que les
anciens bateaux fluviaux mais beaucoup plus profonds, ce sont les grands
"chalands", d'abord en bois, puis en fer, qui atteignent une
capacité de charge de mille tonnes et plus.
Ces chalands sont "tractionnés
par les "toueurs" et les "remorqueurs" à vapeur qui
se substituent aux anciens procédés d'utilisation directe des forces naturelles.

Charles Louis de Saulces
de
Freycinet
né à Ariège
le 14 novembre 1828
et mort à Paris le 14 mai 1923,
est un homme politique et ingénieur français.
Il fut ministre des travaux publics et président du Conseil...
En savoir plus
sur Freycinet ..
Définition historique de Péniche
Anciennement (Source Cnrtl)
1. Petite embarcation pontée et armée, à aviron et à voile, servant d'auxiliaire à un navire de guerre ou utilisée comme garde-côte. L'Empereur se blâmait touchant les péniches de Boulogne. Il eut mieux fait d'employer, disait-il, de vrais vaisseaux à Cherbourg (Las Cases, Mémoires Ste-Hélène, t.1, 1823, p.600). Ayant été embarqué avec sa compagnie pour les besoins de la campagne dans une péniche qui allait de Gênes à je ne sais plus quel petit port de la côte, il tomba dans un guêpier de sept ou huit voiles anglaises (Victor Hugo, Les Misérables., t.1, 1862, p.731).
Par analogie : Bâtiment militaire à fond plat, remorqué ou à moteur, utilisé pour débarquer des troupes et du matériel sur les plages. En France, c'est seulement en mai 1940 qu'on acheva un premier modèle expérimental de péniche de débarquement: on l'utilisa aussitôt en baie de Somme (Le Masson, Mar., 1951, p.49).
C. Populaire, argot, au pluriel : Chaussures (en principe trop grandes). " Lamuse considère ses pieds boursouflés, racornis: −Y a pas d'erreur. I' m'faut des péniches, un peu plus tu verrais mes panards à travers celles-ci... J'peux pourtant pas marcher sur la peau d'mes pinceaux, hein?" (Barbusse, Feu, 1916, p.87).
Étymologie et Histoire :
1. 1803 «canot d'un navire» (Mercure de France, XIII, 142 ds Fonds Barbier)
2. 1804 «embarcation légère utilisée dans l'appui aux navires de guerre (ici dans la flotte de Boulogne destinée au débarquement en Angleterre) (Napoléon, Lettre à Bruno, 8 thermidor, an XII ds Rob.)
3. 1859 «embarcation fluviale destinée au transport de marchandises» (Ponson du Terrail loc. cit.). Emprunté avec déformation par métathèse et changement de finale, à l'anglais pinnace (prononcer [pines]), attesté depuis le 16ème siècle au sens de «petit vaisseau utilisé pour accompagner et aider, grâce à sa maniabilité, des navires plus grands» d'où «canot d'un navire» et lui-même emprunté au mot français pinace (voir pinasse).
Fréq. abs. littér.: 130. Bbg. Baldensperger (F.). Notes lexicol. Fr. mod. 1938, t.6, p.255. _Bonn. 1920, p.104. _Kemna 1901, pp.50-51.

Peniche du nord avec sa voile
Le toueur et le remorqueur

Le
toueur est un bateau symétrique "amphidrome" (il peut naviguer
dans les deux sens); il est équipé pour cela d'un gouvernail à chaque
extrémité.
Il se déhale sur une chaîne, posée au fond de l'eau sur toute
la longueur de la section qu'il doit parcourir, a l'aide d'un treuil mu
par une machine à vapeur, entraînant ainsi derrière lui un "train"
de péniches.
Le remorqueur est un bateau uniquement pro-propulseur équipé
d'une puissante machine a vapeur et d'une hélice de grand diamètre;
comme le toueur, il est destiné à "tractionner" chalands et
péniches sur les rivières canalisées. Le
passage de l'économie du charbon à celle du pétrole, de la machine à
vapeur au moteur à explosion se fait progressivement en un peu
plus d'un demi-siècle. L'accent
est mis désormais sur la construction des routes, puis des autoroutes,
ce nouveau moyen de transport accapare l'attention et les moyens techniques
et financiers.
Les
voies navigables sont alors négligées et elles ne sont pas modernisées.
Cependant, sur ces voies inchangées, un nouveau type de bateau apparaît
et se multiplie, I'automoteur.
En une cinquantaine d'années, de 1920 a
1970, il va progressivement supplanter les anciens bateaux de bois tractionnés. L'automoteur
est un bateau construit en acier, il est propulsé par une hélice entraînée
par un moteur diesel. Il existe sous deux formes: l'automoteur de canal
au gabarit Freycinet (38,50 m sur 5,00 m) et le chaland automoteur de
rivière.
Tous deux se caractérisent par le regroupement a l'arrière d'une
série de locaux fonctionnels: chambre des machines, cabine d'habitation,
timonerie.
Construit
dans des chantiers " savants " dirigés par des ingénieurs travaillant
sur plan, I'avénement de l'automoteur marque la fin des batelleries de
canal traditionnelles.
Depuis
1960 environ, une technique nouvelle d'origine américaine a fait son apparition
sur nos voies a grand gabarit : le poussage.
Le
poussage consiste, comme l'indique son nom, à propulser les bateaux porteurs
par poussage et non plus en les tirant comme dans le cas du remorquage,
du halage et du touage.
En tant que procédé de navigation, il se substitue
donc à ces derniers qu'il a fait disparaître au cours des vingt
dernières années. Ses
avantages sont très importants: il permet d'une part une grande économie
de personnel et d'autre part une plus grande rapidité de manœuvre,
car un "ensemble poussé", les barges "porteuses" plus
le "pousseur", est un dispositif rigide se manœuvrant d'un
seul bloc.
Une
nouvelle génération d'écluses de très grandes dimensions, 24 m de largeur
au lieu de 12 m, sur 180 m de longueur, est apparue sur la Seine. Elles
permettent la circulation d'ensembles poussés gigantesques (1O OOO
tonnes environ) Au
contraire, le réseau Freycinet est abandonné par l'État qui n'y effectue
plus que les travaux d'entretien minimum.
Ne pouvant plus y naviguer
dans de bonnes conditions, les artisans le désertent et se replient sur
les grands axes où ils se retrouvent en concurrence avec la batellerie
industrielle et ses ensembles
Les transports de voyageurs
Les coches d'eau - Les vapeurs
Lieu d'activité et de vie intense, la rivière est aussi un lieu de contacts
humains étroits et prolonges à l'occasion des longs voyages en coche d'eau
où sont mêlées toutes les classes de la société.
Le
coche d'eau est le moyen de transport le plus utilisé par les voyageurs.
Au XVIIème et au XVIIIème siècles, la plupart de nos rivières navigables et de nos canaux possèdent des services réguliers de coches d'eau halés par des chevaux, départs et étapes sont fixés par des horaires, le prix et les conditions du voyage sont affichés. Cependant, on possède de nombreux récits qui nous montrent que malgré cette réglementation, le voyage en coche restait une aventure.
Les
rivières ont connu une des toutes premières formes du machinisme, avec
les bateaux à roues à aubes à vapeur.
Le
bateau à roues joue un grand rôle dans la vie économique pendant un court
espace de temps.
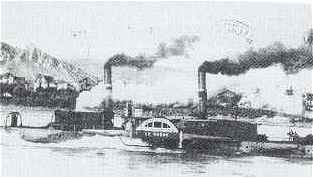
Dès 1825 des compagnies se créent sur la plupart de nos grandes rivières, pour l'exploitation de bateaux à roues; elles assurent le transport rapide des voyageurs et des paquets et prennent la place des coches d'eau.
Elles
disparaissent à leur tour à partir de 1850 devant la concurrence du chemin
de fer qui se généralise et devance la canalisation systématique des rivières. Le
bateau à roues caractérise l'époque du romantisme bourgeois qui voit naître
le "tourisme".
Barrages, écluses, canal
Canaux en péril
Peniche patrimoine fluvial
by Willy Deloux
est mis à disposition
selon les termes
de la licence Creative Commons Paternité
Pas d'utilisation commerciale - Pas de modification
Vous pouvez utiliser le contenu à condition
de placer un lien vers Pnich.com